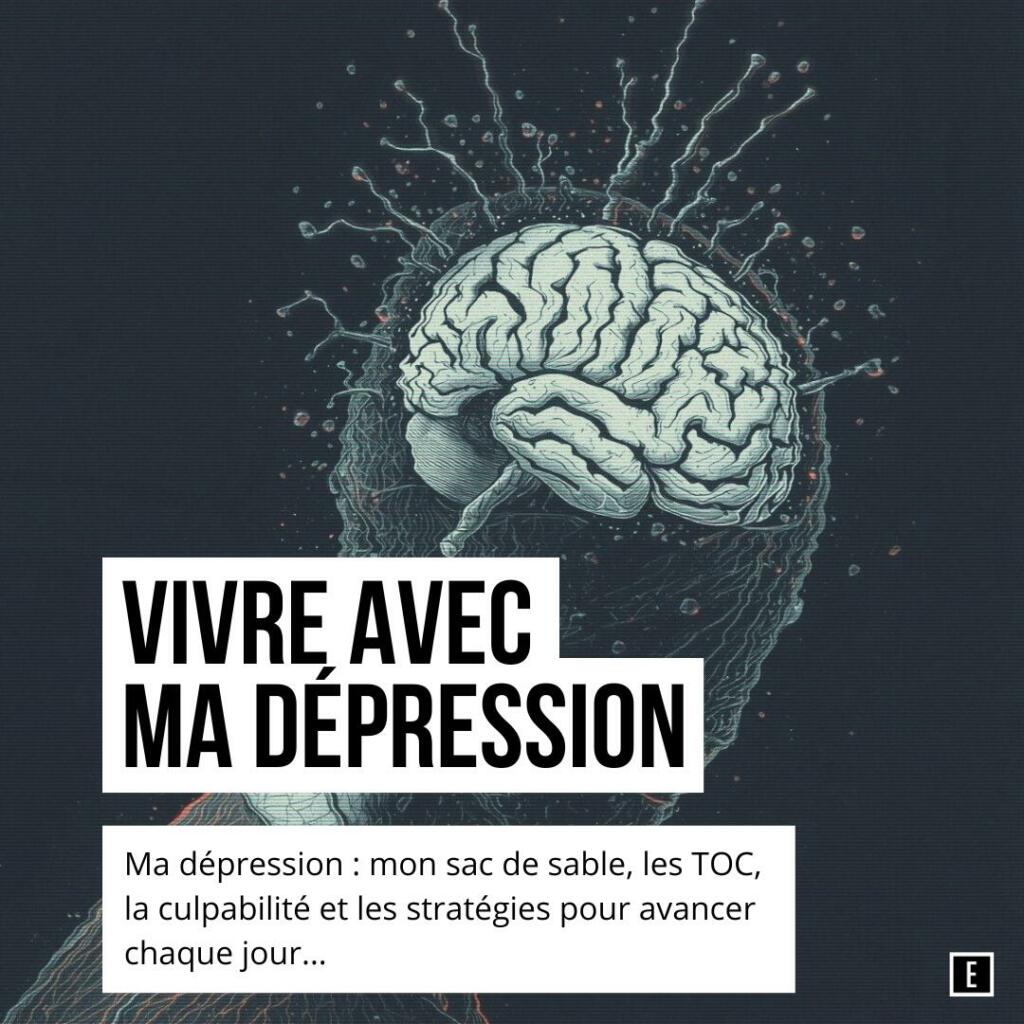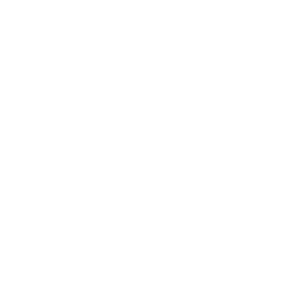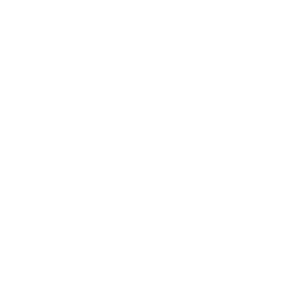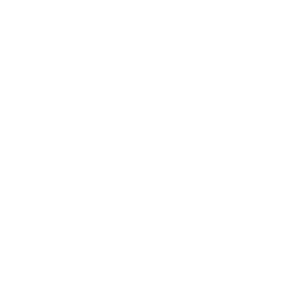La dépression, ce n’est pas juste être triste. C’est un sac de sable sur les épaules. Un poids sourd, écrasant, sur ta poitrine, serre ta gorge, fait battre ton cœur plus fort et ralentit ton souffle. Parfois, tu arrives à en vider un peu, à soulever ce fardeau, à avancer, sourire, travailler, retrouver presque de l’espoir. Et parfois non. Le sac revient, plus lourd, plus froid, plus cruel, et tu sens ton cerveau se figer, tes muscles se crisper, tes pensées tourner dans un brouillard dense. Tu ne fais qu’une ou deux choses dans la journée, pas plus. Ce sera tout ce que ton esprit fatigué accepte. Le reste est hors de portée, invisible, inaccessible, même si tu sais que tu devrais le faire, même si tu le veux. Ton corps bouge, ton esprit non. Tu es là, mais pas vraiment. Cette contradiction te vide et tu te réfugies dans l’ombre, dans le noir, pour tenter de respirer.
Le brouillard mental est épuisant. Les idées défilent, se télescopent, glissent, se répètent sans fin et jamais ne se fixent. Tu veux entreprendre quelque chose, écrire, agir, avancer, mais tes mains restent immobiles, ton regard vide, ton cœur lourd. La dépression enlève ce petit “plus” qui pousse à poser un pied hors du lit, qui fait battre le cœur à l’idée d’un projet, qui donne l’énergie pour se lever et respirer malgré la fatigue. Elle retire motivation, désir, courage. Et cette absence te culpabilise. Pendant des jours, je peux être incapable de faire le moindre geste utile et mon humeur pourrie retombe sur mes proches. Et ça me ronge : je n’ai pas envie de vivre ça moi-même, alors leur imposer, c’est encore pire. La culpabilité devient un poids supplémentaire, qui serre la gorge, écrase le thorax, qui me rappelle que je devrais être mieux, que je devrais faire plus.
Parfois, cette culpabilité m’aide à me reprendre, à forcer mon corps et mon esprit à agir, mais seulement si je suis dans un état qui le permet, sinon, c’est juste une pression qui écrase. Expliquer ça aux autres est presque impossible. Les mots semblent faibles. Les métaphores peuvent passer pour de la folie et provoquer de la pitié, et je ne suis pas fou, je ne veux pas de pitié. Je sais que mes proches m’aiment, c’est évident. Mais parfois, quand je suis mal, je l’oublie. Je crois qu’iels en ont assez de moi, que je suis un poids trop lourd, que je n’ai aucun droit de leur imposer ça. Dans ces moments, je me sabote, s’appelle un “comportements d’auto-sabotage affectif”. Mon subconscient, me pousse à ce que l’amour soit mis à l’épreuve pour confirmer ma propre idée de l’échec, et je n’imagine pas l’effet que ça a sur iels.
Il y a vingt-cinq ans, une psychiatre m’a dit : “peur de l’abandon, hyper anxiété”. Ça sonnait banal. Sauf que ça signifie vivre dans un cerveau en surchauffe permanente, chaque pensée analysée, disséquée, remise en question, pesée, confrontée à mille scénarios. Croire que les gens vont te lâcher. Croire que tu n’es pas aimable. Même quand on t’aime, tu n’y crois pas. Les compliments ne passent pas. La peur, la parano, les TOC, la fatigue, la culpabilité, tout s’entrelace et transforme chaque geste en mini-combat. A cette époque, chaque sortie deviennait un effort monumental, chaque interaction un test invisible, chaque bruit une alerte, chaque geste un potentiel danger.
Les TOC (troubles obsessionnels compulsifs) étaient terrifiants au début. Vérifier les portes, les médicaments, compter, répéter les gestes, refaire encore et encore. Je sais que c’est absurde. Je sais que je passe pour un dingue. Mais si je ne le fais pas, l’angoisse me dévore. J’ai déjà fait demi-tour sur un trajet pour revenir vérifier une porte. Pour les médicaments, parfois plus simple : je les vois tomber ou pas, je sais que je les ai pris. Mais il y a eu des moments où je craignais que les enfants ou le chien trouvent un cachet et meurent, alors que le dosage ne présentait aucun danger. Ma femme m’aide, souvent impliquée dans le rituel : elle regarde ma langue, répète “quatre” à voix haute, parce que j’ai quatre cachets le soir. Le matin, c’est moins contraignant, un simple miroir suffit, et encore pas systématiquement. Parfois ça passe et je peux avancer. Parfois tout revient et je dois recommencer. Quand je n’ai pas de miroir, je trouve des stratégies dérivées : m’installer là où je ne peux manquer de voir si un cachet tombe, m’appliquer à chaque geste. Une porte mal fermée, un doute à plusieurs centaines de kilomètres, et l’angoisse explose, dure le temps qu’elle veut, jusqu’à ce que les scénarios dans ma tête dissipent la peur.
Aujourd’hui, je n’ai plus ces problématiques de parano ou d’agoraphobie. Les débuts étaient violents : Paris, stress, solitude, hypochondrie. Tout a changé quand j’ai déménagé en Bretagne, passé mon permis et acheté ma voiture. Une maison roulante, mon refuge, ma bulle. Ma musique, mon chauffage, mes odeurs, mon espace à moi. Sortir est devenu respirable et contrôlable.
La nourriture est un refuge. Pas par faim, mais pour le geste, pour occuper mes mains, pour calmer le chaos. Quand je suis seul, les enfants partis, ma femme ailleurs, un film que j’aime, je mange pour le plaisir. Comme autrefois avec le tabac : les gestes ritualisés, les moments de tension, les pauses, les rituels du quotidien. Maintenant, un bocal de biscuits, une tartine au milieu de la nuit. Je n’ai pas honte. Parfois je me décourage. Parfois je m’en moque totalement. Parfois je cherche simplement à ressentir quelque chose, à remplir le vide. Ca, ça s’appelle des “rituels compensatoires et recherche de contrôle” ou “comportement auto-apaisant”.
Chaque matin, chaque soir, je prends mes cachets. Vingt-cinq ans que ça dure. Chaque dose me rappelle que je suis malade. La peur d’arrêter est trop forte. Alors je continue. Au début, c’était comme planer : coton, sommeil, oubli. Juste ce qu’il faut pour que le cerveau arrête de tourner. Avec le temps, les effets s’estompent, mais la fatigue reste, c’est la fatigue “iatrogène” ou “hyper-somnolence secondaire”. Un poids constant, qui te pousse vers le lit, qui t’étreint, qui fait battre le cœur plus fort, qui serre la poitrine. Dormir n’est pas fuir, c’est tenir. Le sommeil est une soupape, un refuge, un lieu où je peux être seul·e, réfléchir calmement, récupérer un peu de contrôle sur moi-même.
Le travail, lui, est ma planche de salut. Mon cerveau ne s’arrête jamais. Les idées déferlent, les projets s’entrelacent. Se sentir utile, être à sa place, aider les autres, c’est ce qui me maintient debout. Même si tout n’aboutit pas, même si je me plante parfois, c’est la preuve que je continue, que je transforme la douleur en quelque chose de concret.
Vingt-cinq ans que je cohabite avec ça. Je ne cherche pas à dompter chaque vague. Je navigue, je vis avec, je continue. La dépression n’est pas quelque chose qu’on guérit vraiment. C’est un compagnon de route. Parfois monstrueux, parfois silencieux. Mais avec lequel il faut composer si on veut rester vivant.
Vivre avec la dépression, ce n’est pas finir par s’en débarrasser. C’est apprendre à marcher avec un poids invisible, parfois léger, parfois écrasant. Il y aura des jours où tout semblera possible, des éclairs de lucidité, de sourire, d’envie. Et d’autres jours où la fatigue mentale te cloue au lit, où les TOC, les rituels, les craquages alimentaires, la culpabilité te rappellent que tu n’es jamais vraiment libre.
Mais malgré tout, malgré la brutalité de ces moments, il y a des signes de lumière. Un projet qui avance, un mot qui réconforte, la présence de celleux que tu aimes. Des petites victoires, des gestes simples, des instants de calme, ce sont eux qui te rappellent que tu peux continuer. Que tu peux tenir. Que la vie vaut d’être vécue, même avec ce sac de sable sur les épaules.
La dépression n’est pas une ennemie que tu vaincras. Elle te teste, te fragilise, te brutalise parfois. Mais elle ne t’enlève pas la capacité de sentir, de créer, de donner et de recevoir. Et c’est ça, ces éclats de lumière, qui permettent d’avancer. Même lentement. Même à bout de force.
Je ne suis pas guéri. Mais je suis vivant. Et c’est déjà une victoire.
Diagnostique shorthand DSM‑5
Dépression majeure chronique, modérée à sévère ; trouble anxieux généralisé avec traits d’attachement anxieux ; TOC partiellement compensés ; comportements d’auto-apaisement (alimentation, sommeil) ; ralentissement psychomoteur ; sublimation fonctionnelle préservée ; bon insight.
Traitement : Bromazépam 6 mg/j, Paroxétine (Deroxat) 40 mg/j.